
(Note: Au fil des chapitres il y a plus de photos et moins de textes, sauf le chapitre 4, le plus long)
La musique, primordiale
dans ma vie, le sera durant tout ce voyage. C’est pourquoi j’en parle souvent dans ce livre. À peine mes sacs déposés dans la chambre des gars, je leur demande si je peux mettre de la musique. Je branche mon lecteur laser et la première est la pétillante
Hey nineteen (Youtube) de Steely Dan, puis James Taylor, Carolina on my mind, et Kevin
Parent. J’écouterai son album Pigeon
d’argile environ 50 fois pendant les 6 mois suivants. Pour moi, la musique est l’ancrage qui était là quand j’en
avais besoin. Ce n’est pas une fuite mais une inspiration. Peut-être un refuge, à l'occasion.
Après quatre mois moralement exigeants et de fatigue mentale, et un mois de "repos" pendant les fêtes, nous semblons tous prêts à partir.
Calmes et sereins? Rien de moins sûr.
En arrivant à Dorval, bêtement rebaptisé "Trudeau", je réalise que j’ai trop de bagages. Plusieurs
cadeaux et des choses qui ne serviront que plus tard en Europe, comme le polar et le coupe-vent.
Stécy et Marie-Claude n’ont qu’un modeste sac à dos. Simon
inaugure une nouvelle coiffure, très courte. Il s’en
félicitera.
On le dit souvent avec raison: dans ces longs voyages, le plus difficile n’est pas le départ, mais le retour. Il faut le préparer. C'est ce que j’ai fait ce dernier mois. J'ai ainsi constaté qu’un tel voyage est une occasion de faire du
ménage. En septembre dernier, je suis arrivé à Rivière-du-Loup avec
ma pauvre petite Firefly chargée à bloc. Combien de peccadilles nous
semblent importantes!
À mon retour à Montréal en décembre, j’étais
beaucoup plus léger, au sens matériel, car j’avais laissé bien
des choses à Rivière-du-Loup. Sur le plan mental et émotif, j’étais
beaucoup plus lourd: ce ménage restait encore à faire.
À Bamako, capitale du
Mali,
il fait "frais", un peu sous les 30 degrés.
Cette année, la météo est exceptionnelle, en raison de El Nino.
En février, le mercure touchera les 40 pour ne plus bouger pendant deux bons mois, sauf pour
grimper à 45 ou même 48, le 4 mai.
Un premier arrêt de quelques heures à Boston, j’en profite pour aller prendre un verre et
mâcher un cigare dans un pub. Puis le vol de
nuit de sept heures vers Bruxelles où nous faisons escale pendant deux
heures, et encore cinq heures pour atteindre Bamako.
Bamako, 12 janvier.
Intrigué, je cherche par le hublot des signes que nous approchons d’une grande capitale. Celle-ci compte quand même deux millions
d’habitants. Mais je ne vois rien. Que la savane parsemée d’arbres, ces petites touffes vertes! Des manguiers surtout, une bénédiction pour ce pays de la soif.
Je me dis: "On ne va quand même pas se poser LÀ?

La descente fut pénible pour moi. Un rhume m'a causé une grande douleur aux oreilles, et ça a persisté pendant trois jours. Je suis pris par
surprise quand nous touchons la piste: je n’ai vu venir ni
aéroport, ni rien. Mais on peut dire la même chose de Mirabel, le deuxième aéroport international de Montréal.
Dès que l’agent de
bord nous ouvre la porte, la chaleur nous saisit. Annick est prise de
crampes à l’estomac pendant que nous marchons
vers l’aérogare; peut-être la chaleur, ou le trac. Roselyne Leclerc,
la coordonatrice, est là pour nous accueillir, tout sourire.
Le passage de la douane est vite fait. Nous sommes attendus par une horde de garçons qui se disputent notre clientèle. Mais nous chargeons
nous-mêmes les bagages sur les Jeep et prenons le chemin de la ville, à une dizaine de kilomètres de là. C’est bien le
Mali: paysage sans réelle surprise (sauf Bandiagara, comme on le verra), géographie plane de terre rougeâtre.
Jusque là, ça va pour moi. Tout baigne. Mais attendez.
Vers midi, nous
aménageons chez les Sœurs de la Nativité du Seigneur (la mission
catholique) près du centre-ville. Nous passerons quelques jours
dans cet endroit plutôt agréable, le temps"d’atterrir"
et de préparer le départ de chacun vers différentes villes. Le Mali est presque aussi grand que le Québec. Une tâche énorme pour Roselyne et son homologue
africain Samuel.
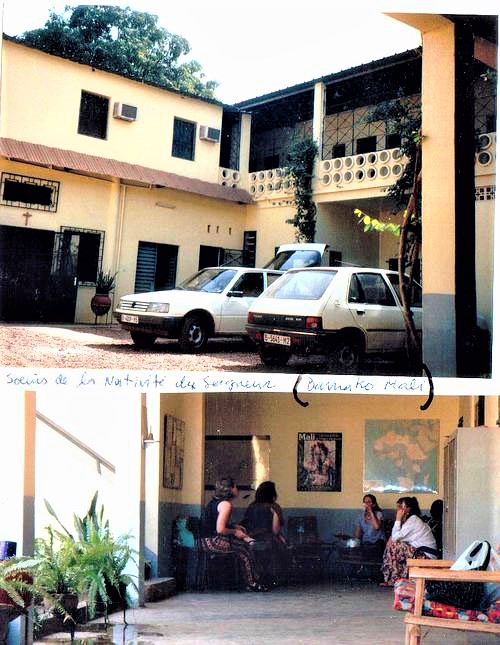
Bamako; les Soeurs de la Nativité.

Bamako centre-ville.
Le choc
Dès le premier soir,
nous partons explorer le quartier. En rangs serrés. Premier choc
culturel pour moi. On nous avait prévenus durant la formation, mais je suis pris de court par la pauvreté, la saleté, l’odeur des égouts à ciel ouvert le long des rues.
Il y a des habitations décentes, mais plusieurs familles logent dans de fragiles cabanes ou dorment à la belle étoile (à cause de la chaleur, souvent).
C’est le repas du soir. Les femmes cuisinent, une grille posée sur des gros
cailloux placés autour du feu. Le bois commence à se faire rare au Mali,
on encourage les gens à utiliser les nouveaux "foyers
améliorés", bien plus efficients.
Stécy, dans sa sagesse habituelle:
"Dire que chez nous, il y
a du monde qui payent pour vivre comme, ça dans les campings."
Voilà que je ne
me sens pas bien; l'angoisse. C'est probablement, au moins en partie à cause du
Lariam, puissant antipaludique (contre la malaria) que j’ai commencé à
prendre avant le départ. J’en ai même pris un dans l’avion. Avec le
Lariam, il y a une longue liste d’effets secondaires possibles, dont
l’anxiété. Pour ces raisons, ma première
nuit à Bamako a été pénible. Le lendemain, je
me suis confié en privé à Roselyne. Spontanément, à sa surprise, je m’appuie sur son épaule et fond en larmes. J'avais rarement pleuré comme ça, aussi sincèrement.
Il faut savoir que ces larmes résultaient aussi de mon séjour à Rivière-du-Loup. Mais j’étais pétrifié par je ne sais trop quoi. J’ai pensé
revenir au pays. Les prochains mois m’apparaissaient soudain comme
une tâche impossible. Je répétais à Roselyne: Toute cette pauvreté, tout ce travail à faire... Je me souviens qu'autour de la vingtaine j'avais eu sporadiquement des symptômes d'anxiété, durant une période relativement courte. "C'était" en veille, quelque part, jusqu'à ce jour, cette combinaison de facteurs: les récents mois exigeants, le Lariam puis le choc de l'atterrissage à Bamako, qui a agit comme déclencheur, la goutte qui a fait déborder...
J'étais aussi en train de faire l'erreur de prendre sur soi le sort de tous ces gens. Pendant les deux jours suivants, je ne suis pas sorti. Même pas pour traverser
la rue. Encore moins pour aller avec le groupe à la rencontre à l’ambassade du Canada. C’était au-dessus de mes forces.
Le 14 janvier, à 8 dollars la page, j’envoie un fax à ma mère, qui prévoyait déjà venir au Sénégal et au Mali en février avec mon frère et ma belle-soeur (j'en parle aux chapitres 3 et 4):
"Avant-hier, j’étais dérouté. On a pris
une marche en ville et j’ai un peu paniqué (...) Bamako est
anarchique, sale, polluée. J’évite la ville surtout le jour, la
boucane me lève le cœur. Le seul point positif est la gentillesse
des gens et c’est un gros point (...) Mais on n’est pas ici pour faire du tourisme et ce n’est pas facile de faire la part des choses."
À la troisième journée, j’ai "osé" traverser la rue pour prendre le petit
déjeuner à la cantine tenue par Mahamane,
un ado d’une quinzaine d'années assez dégourdi. Oeufs brouillés,
légumes, bon pain, confitures, jus d’oranges fraîchement pressé,
café. Le tout pour quelques francs CFA. Une aubaine.
Nous sommes bien accueillis un peu partout. Les Canadiens sont assez
aimés. C’est à partir de cette "aventure" à la cantine, en
affrontant l’objet de mon choc, que mon angoisse s'est calmée, graduellement.
Résurrection à Sanankoroba
Néanmoins, dans ces conditions, je refusais de joindre le groupe pour la retraite à la Case de l’amitié à Sanankoroba, à 45 km au sud de Bamako,
du 16 au 18 janvier. Mais à la dernière minute, j’ai "pris
mon courage à deux mains". J’étais encore anxieux. Nous sommes partis en soirée, vers 22h. Je me suis assis à l’avant de la Land Rover, à côté de Abdulaye, bras droit de
Roselyne. Rassurant, ce Abdulaye, d’un calme exemplaire; je me
sentais bien avec lui, même si je ne le connaissais pas. Souvent, le simple fait de le voir me rassurerait.
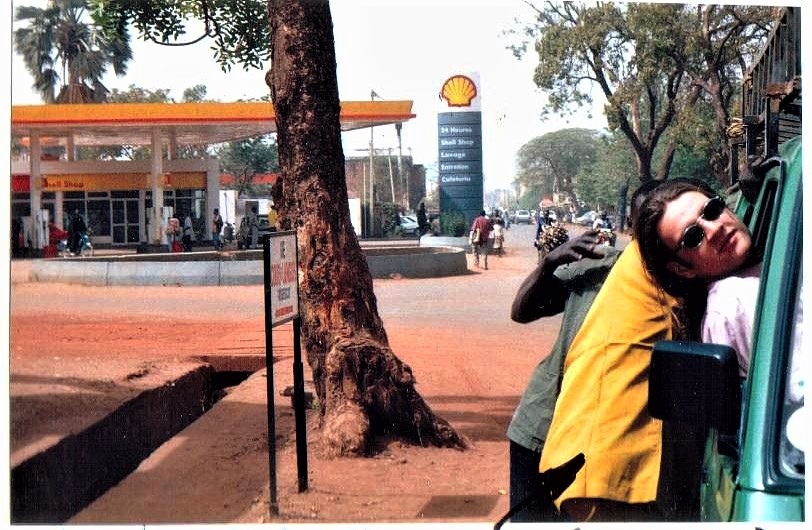
Bamako, centre-ville.
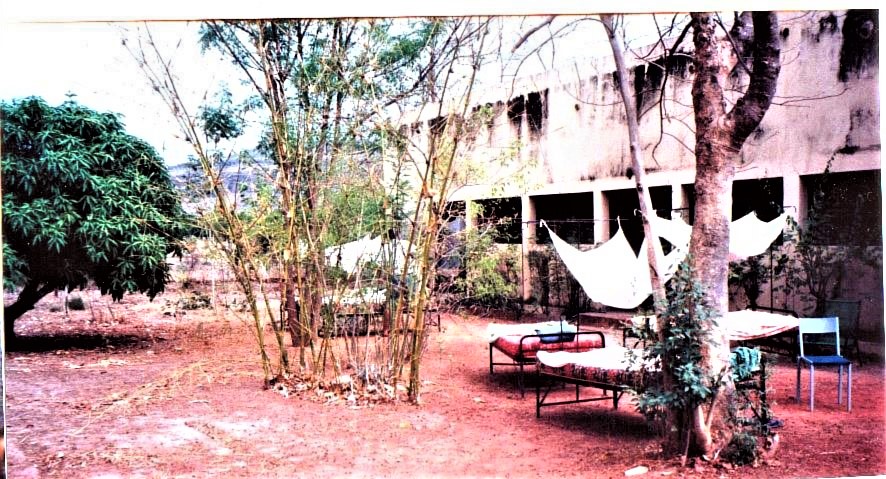
Sébénikoro, près de Bamako. On a dormi dehors. Ne pas oublier la moustiquaire.
Comme la Jeep
prenait la route avec ses sept passagers, j’ai remis mon Walkman. De toute façon nous parlions peu. Je n'étais pas le seul à être plus ou moins sous le choc. J'écoute la chanson et la voix, elle aussi rassurante, de Chris Rea, même s’il
entame son classique The road to hell!
Durant le séjour à Sanankoroba, chacun est jumelé à un(e) Africain(e). La ville elle-même est jumelée à Sainte-Élisabeth, au Québec. Mon homologue, Oumar N’dji Traoré, un mécanicien de mobylettes
qui a déjà visité Sainte-Élisabeth, m’a baptisé du nom de son grand
frère: Jean Traoré. C’est une tradition malienne quand un
étranger s’amène.
Ainsi, à partir de là, quand on me demandera mon nom, je répondrai
invariablement Jean Traoré de Sanankoroba. La personne devant
moi, d’abord surprise, sourira. Ce sera mon passeport pour
l’hospitalité, je ferai partie de la famille malgré la couleur de ma
peau.
À Sanankoroba, je retrouve mes
esprits et le sourire. Je retrouve l’appétit et je mange
avec les autres, les mains dans le grand bol de spaghetti. La crise a passé vite, Dieu merci. Je lis les psaumes.
Mon troisième fax, le 20 janvier, commence ainsi: "Bon bien, tout ne va pas si mal, Dieu merci, au Club Med."
Le 21, dix jours après notre arrivée, je me félicite d’être déjà allé non pas une mais deux fois au centre-ville de
Bamako, tout seul. Je commence presque à prendre mes aises.
Je note déjà un apprentissage: je suis plus fragile émotivement que je le croyais, surtout quand on additionne le choc de l'arrivée, la fatigue physique... et le Lariam.
Après les courses de la journée sous la chaleur, le bruit et la poussière du downtown, le cirque du grand marché digne des Mille et une nuits, je reviens à la mission.
Bière, cigare, Springsteen, "Tunnel of love".
Ça me replace les idées.
Aller au chapitre 2
Aller aux chapitres